Anima Mundi,Votre Beaute
Preuves scientifiques démontrant les capacités cognitives, les réactions émotionnelles, la perception sensorielle, etc. des plantes
Des découvertes scientifiques récentes confirment que les plantes possèdent une intelligence et une conscience. Ils sont capables de sentir, de ressentir et même de communiquer avec leurs voisins. Les plantes sont également capables de se défendre lorsqu’elles sont assiégées, et elles peuvent même conserver la mémoire. La notion d’intelligence des plantes a été explorée par de nombreuses personnalités au cours de l’histoire, notamment Goethe, Luther Burbank, George Washington Carver, Masanobu Fukuoka, Jagadis Bose et Barbara McClintock, lauréate du prix Nobel. En fait, les plantes sont des êtres hautement conscients et intelligents, et elles ont un cerveau, même si ce n’est pas de la manière dont nous l’imaginons traditionnellement.
Des recherches récentes indiquent que les capacités cérébrales des plantes sont plus importantes qu’on ne le pensait, et que leurs systèmes neuronaux sont très développés, parfois autant que ceux des humains. En outre, les plantes produisent et utilisent des neurotransmetteurs similaires à ceux que l’on trouve chez l’homme. Il semble que les plantes soient des êtres très intelligents, dotés de sentiments, et qu’elles soient même plus intelligentes que les humains à certains égards. Par exemple, certaines plantes peuvent effectuer des calculs mathématiques complexes et planifier leur croissance en fonction des conditions météorologiques jusqu’à deux ans à l’avance, entre autres capacités remarquables.
De plus en plus de recherches menées dans différents domaines reconnaissent que l’intelligence est un aspect intrinsèque de tous les systèmes auto-organisés. Cette compréhension remet en question la notion de « chauvinisme cérébral » et reconnaît que les réseaux neuronaux sophistiqués sont caractéristiques de la vie. Le cybernéticien Kevin Warwick souligne que les comparaisons d’intelligence sont souvent biaisées et subjectives, car elles sont basées sur des caractéristiques que les humains jugent importantes. Les rationalistes qui ont longtemps rejeté le concept d’intelligence et de conscience des plantes sont eux-mêmes limités par leurs préjugés subjectifs et ont tendance à trouver que le monde n’est pas conforme à leurs idées préconçues. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’organismes apparemment dépourvus de cerveau, tels que les bactéries, les virus et les plantes.
La croyance commune selon laquelle les plantes sont des entités passives et inconscientes qui se concentrent uniquement sur l’accumulation photosynthétique est un paradigme dépassé. Des chercheurs tels que Baluska et al. soulignent le fait que les plantes sont des organismes dynamiques et sensibles qui recherchent activement et de manière compétitive des ressources, traitent des informations et communiquent avec leur environnement, y compris avec d’autres systèmes vivants. Cette nouvelle compréhension reconnaît les plantes comme des êtres conscients et intelligents, dotés de systèmes de communication complexes, y compris les sentiments et la perception de la douleur, sur une échelle de temps beaucoup plus longue que celle des animaux.
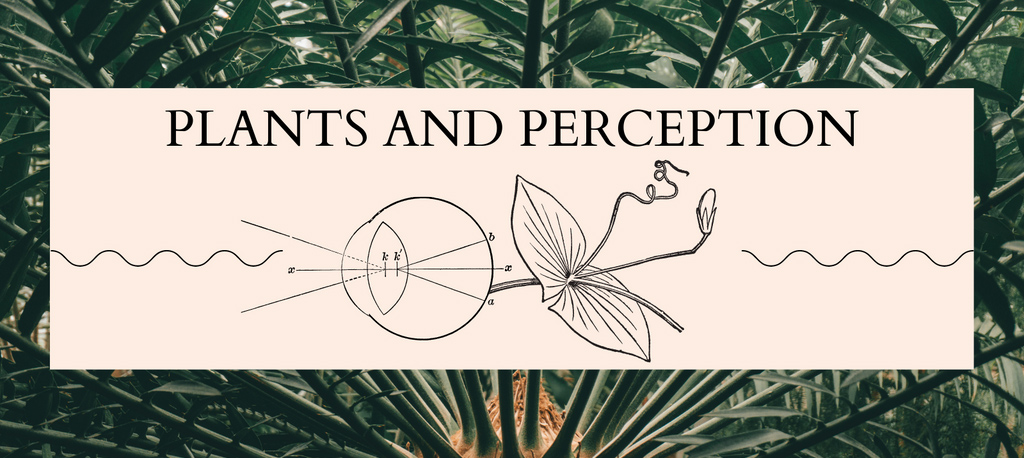

La perspective la plus récente est que les plantes sont des organismes hautement dynamiques et sensibles qui recherchent activement et de manière compétitive des ressources limitées au-dessus et en dessous du sol. Ils calculent avec précision leur situation et utilisent des analyses coûts-bénéfices sophistiquées, prenant des mesures définies pour atténuer et contrôler les conditions environnementales diffuses. Les plantes possèdent une reconnaissance raffinée du soi et du non-soi, ce qui entraîne un comportement territorial. Ce point de vue considère les plantes comme des organismes conscients, traitant l’information et dotés d’une communication complexe, y compris les sentiments et la perception de la douleur. Les plantes se comportent avec intelligence et sophistication, comme les animaux, mais leur potentiel est souvent caché car il s’exprime sur des échelles de temps beaucoup plus longues. En raison de leur mode de vie, les plantes ont développé un système robuste de communication, de signalisation et de traitement de l’information, et interagissent avec toute une série d’autres systèmes vivants.
Les plantes perçoivent et surveillent leurs mondes interne et externe pour y déceler des changements informationnels ou fonctionnels, et elles choisissent la réponse optimale parmi de nombreuses alternatives, rejetant les autres réponses potentielles. Selon M. Trewavas, ces réponses conscientes des plantes sont très intelligentes et impliquent un calcul complexe pour obtenir une réponse optimale face à un nombre presque infini d’environnements différents auxquels les plantes sauvages sont confrontées.
Les plantes comme le rossolis sont incroyablement sensibles au toucher, capables de détecter une simple mèche de cheveux pesant moins d’un microgramme et de réagir en conséquence. Mais ce qui est vraiment remarquable, c’est leur capacité à discerner ce qui les touche et à donner un sens à leur environnement. Bien qu’elles soient considérées comme des êtres passifs, les plantes possèdent une forme très développée de mécanosensibilité qui fonctionne de la même manière que notre sens du toucher. Ils analysent leur environnement, en déterminent la signification et élaborent une réponse, qui implique souvent des changements rapides au niveau de la génétique et de la forme physique. Tout cela témoigne de leur sensibilité et de la communication qu’ils entretiennent entre eux, ainsi que de leur capacité à souffrir et à planifier l’avenir. Bien qu’elles ne ressemblent pas à notre cerveau, les plantes possèdent un système neuronal très sophistiqué qui peut être considéré comme une forme de cerveau, ce qui remet en question l’idée du « chauvinisme cérébral ».
Le cerveau de la plante
Il est courant de penser que les plantes, telles que les arbres, ont une tête et des pieds, la tête étant la canopée de l’arbre et les pieds son système racinaire. Cependant, des recherches récentes ont montré que cette orientation est erronée.
Chez les organismes conscients et complexes, comme l’homme et la plupart des animaux, la tête, ou pôle antérieur, est responsable du traitement de l’information, tandis que le pôle postérieur s’occupe de la reproduction sexuelle et de l’excrétion des déchets. De ce point de vue, les plantes vivent donc la tête dans le sol et l’extrémité postérieure dans l’air.
Lorsqu’une bouture de plante est transplantée dans un nouvel endroit, son système neuronal hautement développé, qui analyse et perçoit son environnement, s’adapte et modifie la forme et la structure de son réseau neuronal et de sa forme physique. Cela lui permet de mieux s’intégrer dans son nouvel environnement. En fait, les plantes possèdent un cerveau racine conscient qui fonctionne de la même manière que le nôtre, traitant les données entrantes et générant des réponses sophistiquées. En outre, le cerveau de la plante est très adaptable, il se moule pour s’adapter à l’environnement dans lequel il pousse.
L’apex de la racine, un composant unique des racines des plantes, agit comme une combinaison d’un doigt sensible, d’un organe sensoriel et d’un neurone cérébral. Un seul plant de seigle, par exemple, contient plus de 13 millions de radicelles, d’une longueur totale de 680 milles, et plus de 14 milliards de radicelles couvrant une longueur de 6 600 milles. Chaque apex racinaire sert d’organe neuronal au sein du système racinaire, les plantes possédant un nombre considérable de neurones, rivalisant même avec le cerveau humain dans certains cas. En revanche, le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones, dont seulement 16 milliards dans le cortex cérébral. Si l’on considère le réseau interconnecté des racines des plantes et des mycéliums mycorhiziens dans un écosystème donné, il devient évident que le réseau neuronal des plantes est bien plus grand que le cerveau d’un être humain. Compte tenu de ces informations, il est surprenant que certains continuent à se demander si les plantes possèdent une conscience ou font preuve d’intelligence.
Les plantes n’ont pas d’organe spécifique, comme le cerveau, pour abriter leur système neuronal. Au lieu de cela, ils utilisent le sol comme strate pour leur réseau neuronal, qui consiste en de nombreuses pointes de racines synchronisées agissant comme un système auto-organisé, à l’instar des neurones de notre cerveau. Alors que notre matière grise est le sol qui contient les réseaux neuronaux, permettant à leur système racinaire de continuer à s’étendre vers l’extérieur aussi longtemps que la plante pousse. La canopée des feuilles agit également comme un organe perceptif synchronisé et auto-organisé, très à l’écoute des champs électromagnétiques, qui peut être considéré comme une partie sous-corticale du cerveau de la plante.
Les plantes utilisent pratiquement les mêmes neurotransmetteurs que les humains, notamment le glutamate et le GABA, l’acétylcholine, la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, l’épinéphrine, la norépinéphrine, la lévodopa, l’acide indole-3-acétique, l’acide 5-hydroxyindole-acétique, la testostérone et l’estradiol, entre autres. Elles utilisent également leur neurotransmetteur spécifique aux plantes, l’auxine, qui est synthétisée à partir du tryptophane, tout comme la sérotonine. Ces composés neuroactifs servent à la communication au sein de l’organisme végétal et à l’amélioration des fonctions cérébrales, tout comme chez l’homme.
L’existence des mêmes messagers chimiques dans les systèmes neuronaux humains et végétaux suggère que les effets de certaines substances, telles que la porphine, la cocaïne et l’alcool, sur nos réseaux neuronaux peuvent également affecter la conscience des plantes. Au début des années 1900, Jagadis Bose a mené des expériences en traitant des plantes avec divers produits chimiques afin d’observer leurs réactions. Par exemple, il a recouvert des arbres adultes d’une tente et leur a administré du chloroforme, ce qui a anesthésié les plantes et réduit leur perception de la douleur. De même, la morphine a réduit la perception de la douleur et le pouls des plantes, tandis que des doses excessives ont entraîné la mort, mais l’administration d’atropine les a ranimées, comme chez l’homme. Bose a également découvert que les plantes pouvaient être droguées par l’alcool, induisant un état d’excitation élevé au départ, suivi d’une dépression et finalement d’une perte de conscience en cas de consommation excessive, similaire aux effets sur les humains. Ainsi, le système nerveux et la conscience de la plante semblent réagir aux produits chimiques de la même manière que chez l’homme.

La communication sociale des plantes
Les racines des plantes font preuve d’un niveau remarquable de conscience et d’auto-conscience, s’engageant activement dans des interactions complexes avec une variété d’organismes vivants. Elles établissent des relations symbiotiques avec des bactéries et des champignons et sont capables de communiquer de manière sophistiquée avec d’autres plantes.
Les bactéries colonisent les racines et produisent des nodules d’azote, que la plante peut ensuite utiliser comme source d’azote, tandis que les bactéries obtiennent les nutriments dont elles ont besoin pour survivre. Les racines forment également des associations intimes avec les mycéliums fongiques, ce qui donne lieu à un réseau sophistiqué de racines et de champignons qui peut s’étendre sur des kilomètres. Ce système de racines mycéliennes/plantes relie toutes les plantes d’un écosystème donné, donnant naissance à un réseau neuronal auto-organisé où la communication entre plantes est à la fois abondante et robuste. Chaque écosystème a une identité unique qui reflète la conscience de la masse végétale à l’œuvre.
Au sein des écoranges auto-organisés, les plantes communiquent entre elles à l’aide de signaux chimiques et auditifs par le biais du réseau mycélien qui les relie. Si une plante détecte qu’une autre plante du réseau est malade, elle peut générer des composés uniques qui sont envoyés à travers le réseau pour aider à la guérison. Ces composés médicinaux sont utilisés par les plantes depuis des millénaires pour se soigner, soigner les autres plantes de l’écorange, ainsi que les insectes et les animaux qui y vivent. Ce type de coopération consciente entre les plantes conduit à un écorange plus adaptable, contrairement à la concurrence et à la lutte constantes entre les organismes. L’idée que la nature est une lutte constante pour la survie est erronée, car les formes de vie s’entraident également tout au long de leur vie. La différence est que les plantes sont des êtres conscients et intelligents.

Les écoranges facilitent l’échange d’informations grâce à une communication chimique complexe entre les plantes par le biais de composés volatils qui se déplacent dans l’air, le sol et le réseau mycélien. Chaque entité végétale génère ces interactions intelligentes et réagit en conséquence, en faisant preuve de conscience de soi et en s’engageant dans des activités sociales similaires à celles des bactéries. Comme les humains, les plantes présentent une série de comportements complexes tels que le langage, la sensibilité, l’intelligence, la création de villes, la coopération de groupe, l’adaptation à leur environnement, la protection de la progéniture et la transmission de la mémoire de l’espèce. En outre, les plantes ont la capacité de fabriquer des outils intelligents en créant des produits chimiques conçus pour produire des effets environnementaux spécifiques.
Les plantes matures émettent intentionnellement des substances volatiles contenant des informations sur les réponses chimiques à la prédation des plantes plus jeunes. Par exemple, lorsqu’un tétranyque se nourrit d’un plant de haricots, la plante peut identifier le type spécifique de tétranyque grâce à sa salive et générer une phéromone adaptée qui est libérée dans l’air par les stomates de ses feuilles. Cette phéromone attire le prédateur exact qui se nourrit de ce tétranyque particulier. Ces connaissances acquises sont stockées sous forme d’apprentissage culturel par les plantes plus âgées, qui les transmettent aux générations plus jeunes. L’apprentissage culturel est omniprésent dans le système gaïen, comme en témoigne l’enseignement des techniques de collecte des termites aux jeunes chimpanzés.
Le monde est constitué d’une série de systèmes auto-organisés imbriqués, tous hautement conscients et intelligents, imbriqués dans des systèmes plus vastes, dont le point culminant est la Terre, une entité biologique vivante et auto-organisée connue sous le nom de Gaia. Stephen Harrod Buhner, auteur de nombreux ouvrages sur la phytothérapie, les maladies émergentes, les écosystèmes et la dynamique gaïenne, donne des conférences internationales sur ces sujets, y compris sur les modèles musicaux et sonores dans le fonctionnement des plantes et des écosystèmes.






























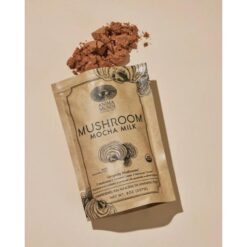


























 Produits de beauté
Produits de beauté Marques A-Z
Marques A-Z Bien-être
Bien-être santé et nutrition
santé et nutrition